Se loger est devenu un luxe. Des travailleurs et des familles vivent dans des camps de fortune. Des bombes explosent, des gens disparaissent. Sidonie, une journaliste frondeuse, braque les projecteurs sur ces zones d’ombre, jusqu’au jour où elle se retrouve de l’autre côté du miroir, dans un lieu où on héberge ceux qu’on appelle désormais « les inlogés ».
Hors du monde et hors du temps – que reste-t-il ? Il reste le stylo.
Dans une langue féroce et ardente, Catherine Leroux explore les notions de chez-soi et de survie, multiplie les couches narratives et les surprises, jouant avec ses lecteurs autant qu’avec son rôle d’autrice.
Des corps qui avaient vécu plusieurs vies, usés vite et mal. Ils avaient la forme des tâches dont personne ne veut, l’asymétrie, la torsion induite à force d’incertitude, de longer des murs. Des corps sculptés au ciseau, à la dépendance, à la violence d’être toujours en dessous, des mots choisis pour les diminuer, de tous les manques, du peu d’égards, de quotidien à l’arrache. Les yeux fatigués de toujours regarder les mêmes petites choses qui passent trop vite.
Ainsi opère le mensonge – son démenti ne nous rend pas la vérité, par une simple soustraction d’information erronée. Même éventé, le mensonge laisse la réalité déformée à jamais.
Être sans logis signifie ne plus avoir de mur, de voile sur soi, sur ses laideurs, ses abandons ou ses désirs, sur toutes les choses que l’on voudrait chuchotées, enfouies; cela signifie être nu. Ici ou dans la rue, on est tué par sa propre transparence, par le regard perpétuel des autres, l’incapacité de parer à cette exposition totale.
J’ai pensé à un peuple de verre, à une ville de coton, mille vertèbres écrasées par le poids de l’hiver, mille vies étranglées.
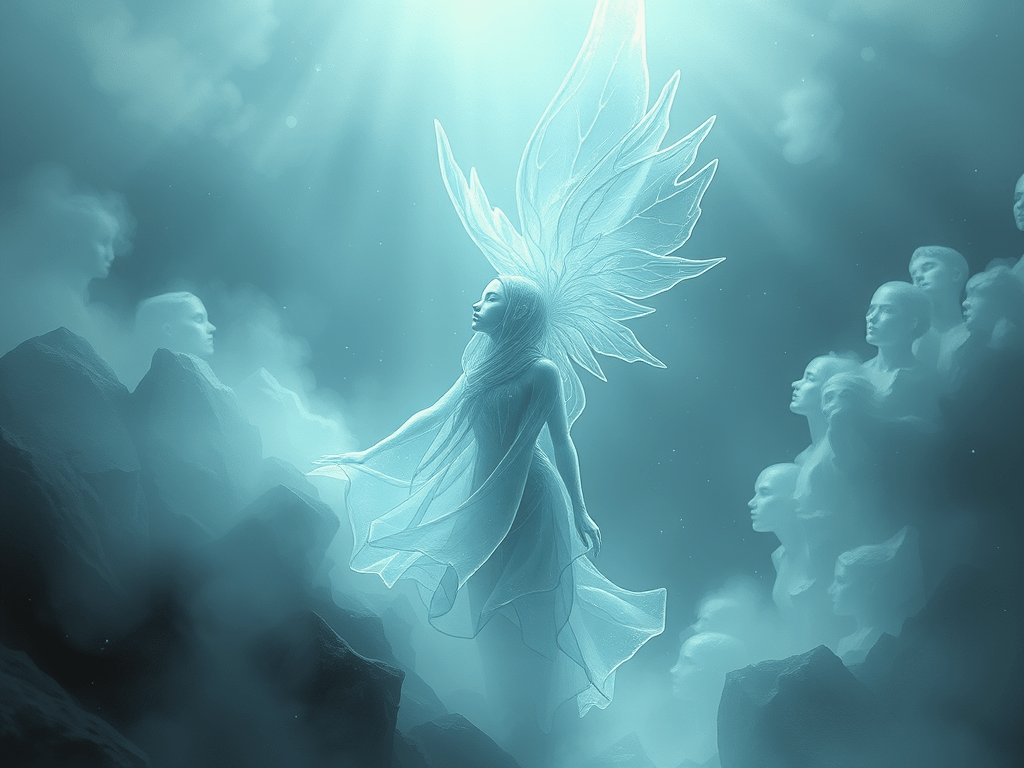

Laisser un commentaire